Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Des institutions d'élite comme Columbia et Harvard jusqu'aux universités régionales moins exposées au regard des médias, les réponses administratives face aux protestations et aux expressions politiques commencent à dessiner un schéma inquiétant : répression, silenciation et exclusion systématique.
Ces décisions, loin d’être des épisodes isolés, répondent à une logique plus large que certains analystes inscrivent dans une perspective biopolitique : la gestion du corps social par le contrôle, la surveillance et la neutralisation de tout ce qui est perçu comme politiquement dysfonctionnel ou menaçant. Au nom de l’ordre institutionnel, de nombreuses universités — historiquement présentées comme des espaces de pensée critique et de pluralisme — adoptent aujourd’hui une posture de plus en plus répressive face à la dissidence, en particulier lorsque celle-ci remet en question la politique israélienne ou exprime sa solidarité avec la Palestine.
L’Université de Columbia illustre clairement ce tournant. Sous de fortes pressions extérieures, son Département d'études du Moyen-Orient a été placé sous supervision administrative, suscitant de vives inquiétudes quant à l’autonomie académique. Parallèlement, des organisations étudiantes pro-palestiniennes ont été suspendues, et des enseignants critiques de la violence exercée par l’État israélien ont perdu leur poste.
L’un des cas les plus représentatifs est celui de Helyeh Doutaghi, universitaire iranienne spécialisée en droit, écartée de son poste après avoir été associée — sur la base d’arguments peu solides — à des organisations accusées de tenir une rhétorique anti-israélienne. Doutaghi affirme que son licenciement est directement lié à sa position publique contre l’offensive militaire à Gaza.
« L’université est en train de devenir un espace de surveillance et d’oppression », a-t-elle dénoncé dans des déclarations publiques. « En collaboration avec l’appareil répressif de l’État, ces institutions établissent des précédents nouveaux et dangereux quant aux règles du jeu dans tout le pays. »
La campagne de répression académique qui se déploie aujourd'hui dans les universités américaines contre les professeurs et étudiants — en particulier musulmans — qui dénoncent le génocide à Gaza peut être lue à travers le prisme théorique proposé par Judith Butler dans son analyse du soi-disant « fantôme du genre ». Selon la philosophe, certains termes — tels que « genre », dans le discours du mouvement anti-genre — sont vidés de leur signification originale et transformés en symboles flottants, omnipotents, susceptibles d’être rendus responsables de tous les maux sociaux. Ils cessent de décrire des réalités concrètes pour fonctionner comme des catalyseurs émotionnels : ils mobilisent les peurs, canalisent les frustrations et justifient des politiques répressives.
Un phénomène similaire se produit aujourd’hui avec le terme « antisémitisme », dont l’instrumentalisation dans certains secteurs du pouvoir politique et académique américain a produit un effet comparable. Loin de dénoncer des discours ou des actes réels de haine, l'accusation d'antisémitisme est activée, dans de nombreux cas, comme un mécanisme pour stigmatiser et punir toute critique de l'État d'Israël, en particulier lorsqu'elle provient de voix musulmanes, arabes ou liées au Sud global.
Dans ce nouveau scénario, la figure de l’universitaire musulman — ou simplement du critique de la violence israélienne — se transforme en un « fantôme » politique : un sujet suspect, idéologisé, infiltré, dont la présence est perçue comme une menace pour la stabilité institutionnelle, la sécurité du campus ou le consensus libéral. Son parcours professionnel, la rigueur de sa pensée ou la nuance de son discours deviennent irrélevants : il devient une cible à neutraliser.
Ce mécanisme symbolique répond à une logique plus large et profondément autoritaire. L'université, loin de fonctionner comme un espace de pensée critique, se redéfinit comme un environnement d’immunisation idéologique, où toute dissidence liée à la Palestine — surtout si elle provient de sujets racialement marginalisés ou de tradition islamique — est traitée non pas comme une partie du débat démocratique, mais comme une anomalie qui doit être éradiquée. Cette opération est enveloppée dans un langage de « tolérance », de « coexistence » ou de « sécurité », tandis que les principes fondamentaux de la liberté académique sont dépouillés de leur contenu.
Dans ce cadre, l'islam — et en particulier un islam politique qui s'oppose au génocide à Gaza — est présenté comme une force invasive et déstabilisatrice, une menace existentielle pour la civilisation occidentale et l'identité nationale. Ce « spectre de l'islam », soigneusement fabriqué et totalement déconnecté des réalités quotidiennes des communautés musulmanes, agit comme un bouc émissaire dans un climat médiatique et politique de plus en plus marqué par la peur et la méfiance.
Le résultat est connu : la rhétorique du terrorisme et de la sécurité nationale est déployée pour discipliner les discours qui, d’un point de vue éthique et politique, remettent en question le statu quo. Et il est utile de rappeler ici que le terme « terrorisme » n'est pas seulement une catégorie descriptive ; c'est avant tout un outil prescriptif. Qualifier quelque chose de « terrorisme » produit un effet immédiat : un répertoire de pratiques répressives — censure, persécution, détention, déportation, voire violence physique — est activé, légitimé par l’existence d’une menace construite et acceptée sans plus de questionnement.
D'un point de vue discursif, le « terrorisme » fonctionne comme une marque d'exclusion. Il désigne l'« autre » — le barbare, le sauvage, l'ennemi intérieur — et l'expulse symboliquement de la communauté politique. Une fois déshumanisé, tout acte contre lui devient non seulement légitime, mais nécessaire à la préservation de l'ordre.
Ce qui se passe aujourd'hui dans les universités américaines n'est donc pas un simple conflit entre liberté académique et gestion institutionnelle. C'est le symptôme visible d'une dérive plus profonde, où des concepts tels que « terrorisme », « antisémitisme » ou même « sécurité » sont utilisés pour justifier l'exclusion systématique des voix critiques, surtout lorsqu'elles proviennent d'étudiants ou d'universitaires musulmans ou solidaires de la cause palestinienne. Sous une rhétorique d'ordre, de neutralité et de tolérance, un régime de surveillance idéologique est en train de se configurer, redéfinissant les frontières de ce qui est dicible et pensable dans le milieu universitaire.
Il ne s'agit pas d'un phénomène isolé ou conjoncturel. C'est une partie d'une offensive mondiale contre toute forme de dissidence qui remet en question les piliers du pouvoir géopolitique occidental. L'activisme palestinien — en raison de sa densité historique, éthique et politique — est devenu, dans ce contexte, une cible prioritaire.
Fin/229



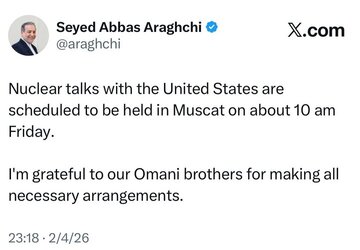


Votre commentaire