Ces dernières années, la guerre commerciale entre les États-Unis et la chine s'est étendue des domaines traditionnels comme l'acier et la technologie à des arènes plus stratégiques. L'un des chapitres les plus récents de cet affrontement porte sue les terres rares ou élément de terres rares (REE), des éléments essentiels qui joue un rôle clé dans la production de technologies de pointe. Ces minéraux, qui comprennent 17 éléments chimiques rares tels que le néodyme, le dysprosium et le lanthane, constituent le fondement des industries modernes, allant des voitures électriques et des smartphones aux missiles balistiques et aux turbines éoliennes.
La Chine, en tant que géant de la production de ces matériaux, contrôle plus de 70% de l'extraction et 90% du recyclage mondiale des éléments de terres rares (REE). Cette position dominante donne à Pékin un fort pouvoir d’influence sur les marchés internationaux. En réaction, les États-Unis ont mis en place des mesures de riposte, ce qui a intensifié les tensions entre les deux pays.
Depuis le début de la guerre commerciale sous la présidence de Donald Trump en 2018, les deux plus grandes économies mondiales se sont engagées dans une spirale de droits de douane, de sanctions et de restrictions à l'exportation. Mais avec le retour de Trump à la Maison Blanche en 2025, son approche "l'Amérique d'abord" a été ravivée avec une intensité accrue.
En réaction aux sanctions américaines visant des entreprises technologiques comme Huawei, ainsi qu’aux restrictions sur l’exportation de puces avancées, la Chine a annoncé le 10 octobre 2025 de nouvelles règles concernant les terres rares. Désormais, une licence spéciale est requise pour exporter tout produit contenant plus de 0,1 % de terres rares. De plus, cinq nouveaux éléments ont été ajoutés à la liste des matériaux soumis à contrôle.
Pékin justifie ces mesures comme '' un cadre de régulation des industries dominantes'', mais Washington les considère comme '' étant hostiles et agressives''. Dans un message sur le réseau social Truth Social, Trump a qualifié cette décision de ''politique diabolique'' qui ''rend la vie difficile pour presque tous les pays du monde''.
En réaction, Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100 % sur les importations chinoises – une mesure qui entrerait en vigueur le 1er novembre 2025 (ou plus tôt, selon les actions de la Chine) et s'ajouterait aux droits de douane actuels (jusqu'à 30 % ou plus). Cette menace, annoncée dans les messages de Trump le 10 octobre est aussi un signal géopolitique.
Trump a également parlé de l'imposition des contrôles à l'exportation sur ''tout logiciel critique'', faisant apparemment référence au secteur technologique chinois, comme l'intelligence artificielle (IA) et les logiciels industriels. Ces mesures ont mis en péril la rencontre prévue entre Trump et le président chinois, Xi Jinping, lors du sommet de l'APEC en Corée du Sud, et Trump a même annoncé son annulation.
Ce cycle de représailles rappelle la première phase de la guerre commerciale entre les deux pays, mais cette fois, en se concentrant sur les ressources stratégiques, le conflit semble encore plus dangereux.
Les raisons de cet affrontement sont profondément enracinées dans des dépendances structurelles. Du côté américain, la principale préoccupation est la sécurité nationale. Les terres rares sont essentielles pour les industries militaires, sans eux, la production des chasseurs F-35, des radars des missiles de précision serait impossible. Le pentagone a signalé que 80% d'importation des terres rares américaines proviennent de Chine, et cette dépendance est considérée comme une faiblesse stratégique dans le contexte de la rivalité avec Pékin pour la domination du Pacifique. Trump et son équipe considèrent cela comme faisant partie d'une "guerre froide économique" et visent à diversifier la chaîne d'approvisionnement. De l'autre côté, la Chine voit les terres rares comme un levier diplomatique. En investissant massivement dans des mines en Afrique et en Australie, Pékin a consolidé sa domination dans ce domaine et l'utilise pour contrer les sanctions américaines.
Les raisons économiques sont également importantes : les terres rares jouent un rôle dans la chaîne de valeur des technologies vertes (comme les batteries lithium-ion), et leur contrôle donne à la Chine un avantage dans la transition vers une économie verte. De plus, des tensions géopolitiques telles que la question de Taïwan et la mer de Chine méridionale ont porté ce conflit à un niveau supérieur.
Les conséquences de cette escalade sont vastes et complexes. À court terme, les marchés mondiaux ont été secoués : les indices boursiers ont chuté dans de nombreux pays, tandis que les prix des terres rares ont fortement augmenté à Londres et à Shanghai.
Les droits de douane de 100 % imposés par Trump pourraient doubler le coût des importations chinoises, ce qui se répercuterait sur les consommateurs américains — du prix des smartphones à celui des voitures électriques. Des entreprises comme Apple, Tesla et Boeing, qui dépendent des terres rares, risquent de subir des perturbations dans leur chaîne d’approvisionnement.
Pour la Chine, ces taxes douanières menacent 500 milliards de dollars d’exportations vers les États-Unis, ce qui pourrait faire passer sa croissance économique de 5 % à moins de 4 %.
À long terme, cette guerre pourrait conduire à une récession mondiale, comme ce fut le cas en avril 2025 avec les précédents droits de douane. Cependant, des opportunités existent également : les États-Unis ont augmenté leurs investissements dans les mines nationales (comme McDermitt Mountain en Californie) et chez leurs alliés comme l'Australie et le Canada, ce qui pourrait réduire leur dépendance jusqu'à 50 %. La Chine pourrait également se tourner vers des marchés alternatifs comme l'Europe et l'Afrique.
En fin de compte, cette bataille pour les "terres rares" est une guerre pour la maîtrise de l'avenir de la technologie. Si Trump met en œuvre ses droits de douane, le monde sera confronté à une crise grave qui ralentira l'innovation et attisera les tensions géopolitiques. Des négociations urgentes sont la seule issue à cette impasse, mais compte tenu de la rhétorique virulente de Trump et du silence prudent de Xi, une perspective pacifique semble peu probable.



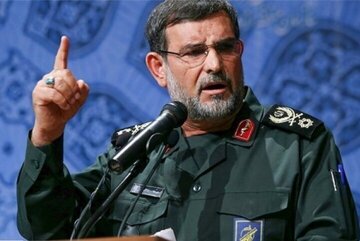


Votre commentaire